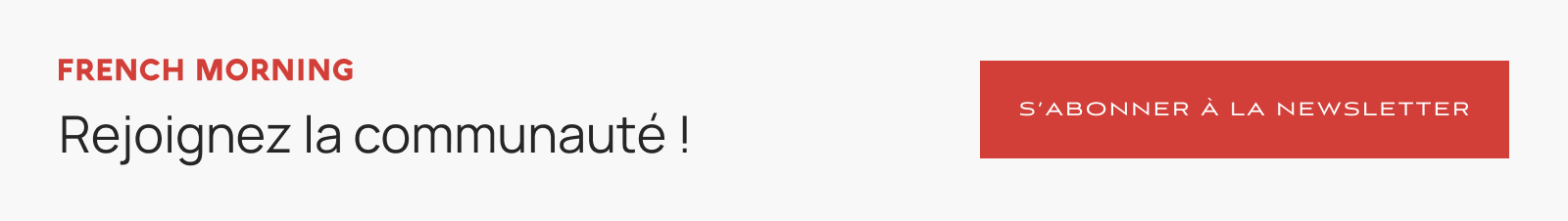Une Américaine, vivant dans un quartier avec une large communauté francophone, m’a dit un jour: « Les Français, on les reconnaît vite. À la piscine, ils arrivent les premiers, le matin, pour prendre les chaises longues, ils les regroupent dans un coin pour discuter entre eux toute la journée et ils sont les derniers à partir. Ce sont également les derniers à s’inscrire sur la liste des volontaires pour l’entretien des lieux… quand ils s’inscrivent ». Je n’ai pas pu m’empêcher de sourire. Elle avait découvert notre “savoir-vivre” bien gaulois. Elle ne pouvait pas comprendre l’absence de réflexe à agir collectivement pour le bien-être de tous.
Mon précédent article sur “les mères françaises” a déclenché des commentaires parfois virulents. Preuve que nous sommes tous à la recherche du meilleur modèle pour élever nos enfants. Preuve surtout, qu’il n’y a pas de modèle. Mais nous, parents français immergés dans la culture américaine, avons une chance: nous pouvons profiter du meilleur des deux mondes. Comme l’a dit justement un commentateur de mon premier article: « il est beaucoup plus facile d’élever un enfant “à la française” aux États-Unis qu’en France (…) car, aux USA, il y a un environnement positif pour les enfants ». C’est avec cette phrase en tête que j’ai écrit ce nouvel article en tentant de souligner ce que j’aime tant dans l’éducation américaine ou, pour continuer sur le mode provocateur, “pourquoi les mères américaines sont supérieures” (c’est fou l’impact que peut avoir un titre de journal!). À partir de petits faits quotidiens, d’anecdotes véridiques, voici l’éducation “à l’américaine” telle que je la vis avec ma famille depuis 7 ans.
“Welcome!”
Avant notre départ de France, mon fils aîné était scolarisé en maternelle. À New York, il est entré en Pre-K (équivalent 2e année de maternelle) à l’école publique de notre quartier. Je suis passée d’un monde où les parents doivent lâcher leurs enfants à la porte des classes dès le 2e jour de la rentrée, à celui où les parents sont vivement invités à accompagner leurs enfants dans leur classroom et à penser, à la fin du premier trimestre, à écourter les “au revoir”. Je ne peux pas dire ce qui est le mieux pour les enfants – dans les deux cas mon fils pleurait au moment de la séparation – mais pour la mère, ce sentiment d’être bienvenue a fait – et fait encore – toute la différence. Il m’a aidé à intégrer mon nouvel environnement, à percevoir ce que mes enfants vivaient une grande partie de la journée. Ces quelques minutes passées dans les classes sont une excellente occasion de connaître les professeurs – un formidable “traquenard” car il est, du coup, plus difficile de leur refuser mon aide – et de rencontrer les autres mères…
WonderMoms
L’une de mes voisines, Jennifer, mère de 4 enfants, travaille à mi-temps chez General Electric, 3 jours par semaine. Ses 2 jours libres sont consacrés à l’école: réunions de PTO (Parent Teacher Organization), lecture dans les classes, animation d’ateliers. Elle prend des jours de congé pour la staff appreciation week (semaine durant laquelle les parents manifestent leur reconnaissance envers le personnel scolaire) et pour la célébration de fêtes en classe (Halloween, Thanksgiving, Hanoucca, Noël, Saint-Valentin… la liste est longue.). Son dévouement rend l’école bien plus vivante et il semble naturel. Même après plusieurs années de bénévolat au sein des établissements scolaires de mes enfants, je dois toujours me forcer un peu. Au fond, j’avais été habituée en France à ce que l’école fonctionne sans moi et c’était plutôt confortable.
Des Jennifer, j’en rencontre tous les jours. Ce sont ces mêmes WonderMoms que je retrouve, le week-end, en train de ramasser les ordures abandonnées dans les parcs et sur les plages, ou de repeindre les lampadaires tagués de leur quartier revêtues d’un tee-shirt “We love our street”. Elles sont bénévoles, soucieuses de leur environnement et initient leurs enfants au sens communautaire.
Community service
« À l’âge de 13 ans, j’ai planté une dizaine d’arbustes dans le square de ma ville. 40 ans plus tard, ils sont toujours là, ils sont devenus de grands arbres et forment un coin ombragé bien agréable dans la chaleur de l’été! ». Mon amie Regina, mère de 3 enfants, aime évoquer ses années de community services, ces “travaux d’intérêt général” qu’il vaut mieux traduire par heures de bénévolat. A partir de middle school (équivalent collège), tous les adolescents américains doivent donner de leur temps au service des autres: au sein de leur école, de leur association sportive, de leur lieu de culte… qu’importe, pourvu que leur action bénéficie à la communauté. Ça fait partie du programme pédagogique, c’est obligatoire pour entrer en high school (lycée) et pour poursuivre des études universitaires. Toutes les mères ont des souvenirs à partager avec leurs enfants et peuvent ainsi parler de participations concrètes au bien-être collectif. Elles ne racontent pas toujours tout (ma voisine Laureen m’a confié avoir gardé un profond dégoût de l’odeur d’éther depuis l’époque où sa mère la traînait dans les hôpitaux pour faire la lecture aux malades) mais je les ai toutes entendues reconnaître la nécessité de cette expérience dans leur éducation.
Je ne sais pas quoi répondre lorsque mes enfants me demandent ce que j’ai fait pour mon quartier. Ils me questionnent beaucoup sur le fonctionnement de ces community services qu’ils s’apprêtent à effectuer. Les jeunes Américains, eux, ne sont pas déroutés: ils ont vu faire leurs mères dès le berceau.
Le réflexe de solidarité
C’est dans un contexte particulièrement tragique que j’ai pu pleinement apprécier la solidarité à l’américaine. Nous vivions alors à Chicago. Une amie, mère française de deux enfants scolarisés dans l’école bilingue de notre quartier, est décédée des suites d’un cancer. La communauté francophone la connaissait bien et, unie, est venue soutenir la famille endeuillée. Chez les Américains, l’élan de solidarité fut instantané: en apprenant la nouvelle, les mères ont aussitôt offert de cuisiner à tour de rôle pour soulager le mari de la défunte. Ce dernier m’a avoué avoir reçu des plats de familles qu’il ne connaissait pas. Et cela a duré des mois.
J’ai – hélas – à nouveau vécu cette situation deux années plus tard dans notre quartier de Nouvelle-Angleterre. J’ai retrouvé cet élan d’entraide spontané autour de la famille plongée dans la peine. Je pense souvent à ce que je ferais si pareil cas se produisait en France. Offrirais-je spontanément mon aide à une famille que je ne connais pas? Mes enfants n’ont pas à se poser la question, ils ont définitivement acquis le réflexe de solidarité.
Est-ce caricatural? Sans aucun doute. L’éducation “à l’américaine” revêt encore bien d’autres aspects, d’autres valeurs, tout comme l’éducation “à la chinoise” ne se réduit pas à la formation de virtuoses et l’éducation “à la française” à l’apprentissage d’une attitude “polite and well-behaved”. Mais c’est l’Amérique que je vis et qui me nourrit. Un grand merci à toutes les mères américaines qui ont accepté de débattre sur nos différences au quotidien – avec souvent un sens aigu de l’autocritique – et qui continuent d’inviter mes enfants… avec le sourire!
Pourquoi les mères américaines le sont aussi…
Par Elisabeth Guédel / Le 1 février 2011 / Actualité
DERNIÈRES NEWS
French Morning
Rejoignez la communauté !
S’ABONNER À LA NEWSLETTER