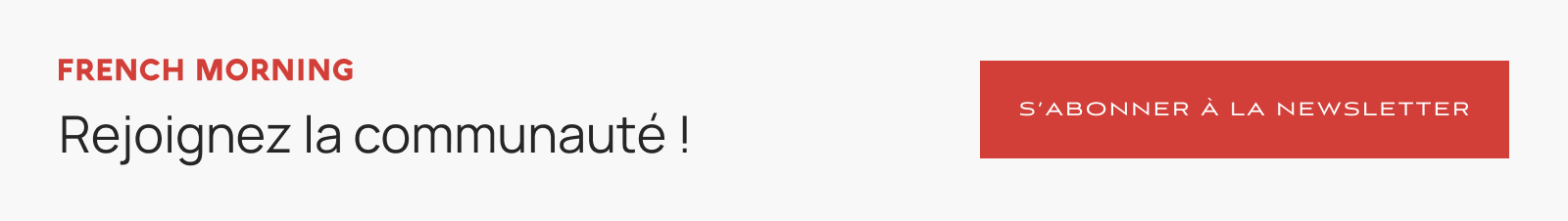“Ce sont les moments les plus forts de toute notre vie mais il faut avoir le cœur bien accroché.” Philippe et Dorian (prénoms changés), trentenaires homosexuels résidant au Benelux, sont, depuis mai 2017, les heureux parents de jumeaux nés en Pennsylvanie d’une mère porteuse. Une expérience formidable, disent-ils, qui aura nécessité près de deux ans d’attente. “C’est un projet long, compliqué et semé d’embûches potentielles”, raconte Philippe.
Philippe et Dorian font partie de ces Francais qui traversent l’Atlantique pour mener à bien une gestation pour autrui (GPA), la France interdisant cette pratique mais les Etats-Unis l’autorisant – ou, du moins, la tolérant – sur une partie de leur territoire. L’agence de mères porteuses, Reproductive Possibilities, basée dans le New Jersey, indique à French Morning que 5 % de ses clients sont Français. Une autre agence, CSP Surrogacy, située dans le Maryland, affirme quant à elle avoir eu affaire à 150 Français en 21 ans d’existence.
Si ces Français se tournent vers l’Amérique plutôt qu’un autre pays, c’est, selon Philippe et Dorian, pour des raisons “éthiques”. “Aux Etats-Unis, ce genre de projet est très bien encadré sur les plans juridique, médical, psychologique et social pour la mère porteuse”. D’autres “parents intentionnels”, comme on les appelle, ajoutent qu’il n’est pas question pour eux de faire cette démarche en Ukraine, en Inde ou en Russie où cette pratique n’est pas encadrée par la loi et où les femmes candidates sont soumises à peu de contrôles. Les agences américaines des couples interviewés exigent toutes que les mères porteuses aient déjà des enfants et qu’elles soient financièrement indépendantes. Ce sont en outre ces dernières qui sélectionnent les couples dont elles souhaitent porter le bébé, et non l’inverse.
Il existe deux types de mères porteuses, indique Margaret Swain, une avocate du Maryland spécialisée dans ce domaine : celles dites de gestation, qui ne partagent pas de patrimoine génétique avec l’enfant qu’elles portent, et les traditionnelles, qui sont aussi les mères biologiques. Les mères porteuses évoquées dans cet article entrent dans la première catégorie. Elles n’ont en général aucun droit sur l’enfant, contrairement aux secondes.
“Un saut dans l’inconnu avec des personnes à des milliers de kilomètres”
En entamant leur parcours du combattant, Philippe et Dorian se sont donnés un maître mot: la confiance. “Il faut arriver à lâcher prise, sinon on tombe facilement dans la paranoïa car, après tout, il s’agit d’un saut dans l’inconnu avec des personnes à 7.000 voire 10.000 kilomètres que l’on a jamais vues”.
Philippe et Dorian ont trouvé une agence à Boston, une mère donneuse dans le Michigan, une clinique pour le don de sperme à Los Angeles et une mère porteuse, Kelly, en Pennsylvanie. “On a rencontré Kelly par Skype, racontent-ils. C’était très curieux mais on s’est tout de suite entendu.”
Enjoué, le couple pointe néanmoins l’aspect “extrêmement coûteux” de l’expérience. “On a payé Kelly 25.000 dollars. On a également pris en charge ses frais médicaux, l’assistance à domicile, la nourriture. Ces frais sont doublés en cas de grossesse gémellaire. Le coût total du projet est difficile à chiffrer car l’agence prend une marge sur un certain nombre de services (test psychologique pour la mère porteuse, frais de gestion juridique, etc.). On pense que cela nous a coûté plus ou moins 150.000 dollars.”
“La mère porteuse ne buvait que du soda, j’étais hystérique”
Sophie, une Parisienne souffrant d’insuffisance cardiaque, a pour sa part dépensé toutes ses économies pour avoir son deuxième enfant grâce à une mère porteuse. “J’ai hésité pendant 3-4 ans, se souvient-elle. J’ai fait un premier voyage aux Etats-Unis en 2012, c’était très angoissant. Quand je me suis finalement lancée avec mon mari, j’étais bardée de tous côtés: j’ai pris deux assurances et plusieurs avocats. On a dépensé 110.000 euros, dont 10.000 pour les allers-retours entre la France et les USA (Sophie a fait venir la mère porteuse à Paris à trois reprises, NDLR). On aurait pu dépenser moins, c’était un choix.”
Tout s’est déroulé comme prévu jusqu’aux dernières semaines avant l’accouchement, où Sophie se dispute avec la mère porteuse. “Elle ne buvait pas d’eau, que du soda, et ne mangeait pas de légumes, précise-t-elle. Cela me tracassait pour le bébé car, en ce qui me concerne, je ne consomme que du bio. Les médecins m’ont aussi dit qu’elle ne s’alimentait plus et qu’elle passait ses journées au lit à regarder des séries télé. Je l’ai harcelée. Une diététicienne a fini par lui dire qu’il fallait qu’elle mange. J’avais les hormones en folie, j’étais hystérique”, ajoute-t-elle.
Sophie évoque également la période stressante de l’après naissance, “là où commence le marathon pour obtenir acte de naissance et passeport américains”. “On a fait une demande express via une agence qui nous a obtenu un rendez-vous en quelques jours pour le passeport, cela nous a coûté 300 dollars. On avait tout prévu avant. Quinze jours après, on a pu prendre l’avion et rentrer à la maison”, ajoute-t-elle, précisant qu’elle s’est gardée de dire aux autorités que son enfant était né d’une GPA.
“Intimidés”
Le retour en France et les potentielles galères administratives sont justement un sujet de tracas pour Stéphane et Julien, un couple homosexuel vivant à Paris et essayant d’avoir son premier enfant aux Etats-Unis. “On a pris un avocat pour préparer notre retour après la naissance du bébé, et notamment la délicate étape de la déclaration de naissance auprès de l’état civil.”
Depuis le 5 juillet dernier, la loi française stipule qu’un enfant né de cette manière à l’étranger peut avoir deux parents français légalement reconnus, et non le seul père biologique, comme c’était le cas jusqu’à présent (en droit français, la mère légale ne peut pas être autre que la femme qui accouche). Toutefois, le parent qui n’a pas de lien biologique avec le bébé doit passer par une procédure d’adoption. La transcription pure et simple de l’état civil d’un enfant établi hors de l’Hexagone a quant à elle été refusée par la Cour de cassation.
Aux Etats-Unis, Stéphane et Julien se paient également les conseils d’un avocat – dont le rôle est d’établir le contrat et de régir leurs relations avec la mère porteuse – et sont épaulés par une psychologue. Pour eux, l’anglais représente une barrière. “Lorsqu’on a rencontré la mère porteuse, on était intimidés et le fait que ce soit dans une langue étrangère n’a pas aidé”, disent les deux hommes, qui chiffrent approximativement le coût de leurs démarches à 150.000 dollars, dont 40.000 dollars pour la mère porteuse.
Leur désir d’enfant les a par ailleurs décidé à se passer la bague au doigt, fin 2016, pour “multiplier leurs chances”. Dans certains Etats comme le New Hampshire, la GPA est en effet accessible aux couples homosexuels à la condition que ces derniers soient mariés.
Français, ils ont eu recours à une mère porteuse aux Etats-Unis
Par Charlotte Oberti / Le 4 septembre 2017 / Actualité
DERNIÈRES NEWS
French Morning
Rejoignez la communauté !
S’ABONNER À LA NEWSLETTER