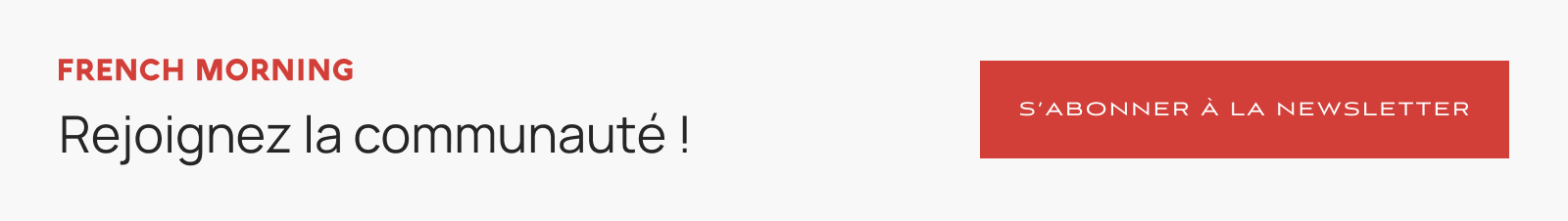A chaque élection, les « lycées français » à l’étranger se retrouvent au centre d’une polémique. En 2007, c’était la question de la Prise en charge (PEC) intégrale des droits de scolarité pour les enfants français de ces établissements qui provoquait un tollé. En 2012, rebelote. Julien Balkany, candidat divers droite au siège de député des Français d’Amérique du Nord, déclarait vouloir rendre les enfants français prioritaires à l’inscription, en cas de saturation des classes et impossibilité d’en ouvrir de nouvelles: «Au Lycée français de New York cette année, il y a douze places disponibles en 1ere année de la maternelle et plus de 250 demandes d’inscriptions. […] On a pris le fils [du magnat de l’immobilier] Donald Trump, la fille de Madonna et les enfants d’Angelina Jolie. Je trouve cela inacceptable. Si je suis élu, ils pourront se trouver une autre école», a-t-il dit, selon l’AFP. L’emballement médiatique fut tel que M. Balkany s’est senti obligé de préciser ses propos et l’institution de l’Upper East Side de sortir de sa traditionnelle réserve pour rappeler, dans un communiqué, qu’elle est une « école privée » ayant vocation à « accueillir le plus de nouveaux élèves possible, dans les limites de ses espaces disponibles et en préservant la mission qui est la sienne depuis sa création en 1935 ». Pour rappel, le LFNY accueille 36% d’élèves non-Français.
«Tous ces bruits viennent de gens qui s’excitent pour faire parler d’eux, grogne un parent d’élève, face à ces polémiques à répétition. Le lycée est un établissement extraordinaire, qui offre une éducation excellente ».
Vecteurs du rayonnement français dans le monde ou repaires d’expatriés privilégiés, les “lycées français”, nom communément donné aux établissements à l’étranger homologués par le Ministère de l’Education nationale, divisent. Le débat est particulièrement aigu aux Etats-Unis. Selon un rapport du Sénat en 2009, huit des dix écoles les plus chères se trouvent sur le sol américain. Et la situation ne s’arrange pas : un autre rapport, signé des parlementaires UMP Sophie Joissains et Geneviève Colot en novembre 2010, évoque une augmentation généralisée des frais d’écolage ces dernières années. Dans son état actuel, la PEC, ou « gratuité », ne semble pas adaptée pour venir en aide aux parents qui ne peuvent plus suivre. En effet, jugée trop coûteuse, elle ne s’applique aujourd’hui qu’aux classes de lycée (seconde, première, terminale) aux droits de scolarité pratiqués pendant l’année scolaire 2007-2008. Aux Etats-Unis, seuls douze établissements sont concernés, les autres ne proposant que des niveaux de primaire et de collège. Etendre la PEC à tous les cycles scolaires coûterait “quelque 700 millions d’euros” selon un rapport parlementaire publié en 2010. Un chiffre que contestent les pro-PEC, qui affirment que l’extension coûterait deux fois moins.
La fin de la « gratuité » ?
Après l’élection, dimanche, de François Hollande, qui s’est prononcé pour la suppression de la PEC au profit d’un système de bourses scolaires, l’avenir de la « gratuité » dépendra du rapport de force gauche-droite à l’issue des législatives de juin. En Amérique du Nord, où l’élection aura lieu les 2 et 16 juin, les principaux candidats n’ont pas attendu la présidentielle pour prendre position. Frédéric Lefebvre (UMP) veut la maintenir et progressivement l’étendre à tous les cycles scolaires, conformément au projet initial de M. Sarkozy en 2007. M. Balkany (divers droite) propose de la remplacer par un « compte d’éducation individuel », doté pour chaque enfant de deux à trois années de scolarité gratuite et utilisable à n’importe quel moment, tandis qu’Antoine Treuille (divers droite) veut soumettre son attribution à des “critères économiques“ pour que les parents qui en ont les moyens ou qui travaillent pour des entreprises couvrant la scolarité des enfants ne profitent pas de l’effet d’aubaine. Carole Granade, candidate du MoDem, propose quant à elle un “étalement” de la Prise en charge jusqu’à la 6ème, en gardant le montant global au niveau actuel. Les candidates du Front de gauche, Céline Clément, et du Parti Socialiste-EELV, Corinne Narassiguin, appellent à la suppression pure et simple de la « gratuité » pour s’appuyer sur le seul dispositif de bourses attribuées par l’Etat français sur critères sociaux. Melle Narassiguin propose de moduler le montant de ces bourses selon un barème régionalisé qui prendrait davantage en compte le coût de la vie locale.
Explosion des frais de scolarité
Bourses ou PEC : le problème de fond reste celui de l’augmentation des frais de scolarité. Celle-ci, conjuguée à l’accroissement du nombre de boursiers (+14,5% entre 2001 et 2010, selon le Sénat) en raison de la crise notamment, met le dispositif d’aide à la scolarité sous pression. Certains candidats suggèrent d’encadrer ces hausses, en les faisant dépendre du niveau de l’inflation par exemple. Problème : la stabilisation des frais d’inscription fait déjà partie des cinq missions attribuées, dans le Code de l’éducation, à l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger) , qui chapeaute le réseau d’établissements étrangers homologués. Et, aux Etats-Unis, cette agence n’a aucune prise directe sur ses membres, car ils sont tous des institutions privées, de droit local, et pour la plupart, simplement homologuées par l’Education nationale. Résultat: en matière de frais de scolarité, l’agence est uniquement habilitée à faire des « observations à ces établissements homologués, qui sont majoritaires aux Etats-Unis (41 sur 43) », précise Raphaëlle Du Tertre, porte-parole de l’AEFE. Dans le cas des deux établissements restant, (Rochambeau à Washington et La Pérouse à San Francisco – en photo) qui sont dits « conventionnés » car ils ont passé une convention administrative, financière ou pédagogique avec l’AEFE, l’agence peut « faire des préconisations ».
La mise en place de mécanismes coercitifs exigerait une modification de la charte qui régit les liens entre l’agence et les établissements membres. Mais un tel effort pourrait se heurter à l’opposition des proviseurs (et de leurs conseils d’administration), peu enclins à laisser dicter la gestion de leur établissement par l’Etat français.
Privilégier les alternatives aux lycées français
Les polémiques autour des “lycées français” ne doivent pas masquer une réalité : un peu de plus de 14 700 enfants de Français aux Etats-Unis sont inscrits aujourd’hui dans ces établissements. Une goutte d’eau. Ces derniers doivent compter avec l’émergence d’options alternatives, plus abordables, dans les écoles publiques notamment. Ainsi, à New York, l’association de parents d’élèves EFNY (Education française à New York) a développé, avec le soutien de l’Ambassade, sept programmes d’immersion français-anglais dans des écoles publiques de la ville, et sept after-school. De tels programmes voient également le jour à San Francisco, Los Angeles, où une classe de Kindergarten bilingue ouvrira l’an prochain, et au Texas, grâce notamment aux subventions accordées dans le cadre du programme FLAM (Français langue maternelle) qui vise à soutenir des initiatives d’enseignement du français en dehors de l’école. En Amérique du Nord, les 14 projets FLAM sont dotés d’un budget total de 178 500 euros. Insuffisant selon Catherine Poisson, présidente d’EFNY. “La somme que nous percevons (dans le cadre du programme FLAM) couvre 8% de nos frais, 2 à 12% dans les autres associations (…) Il faut au moins tripler l’enveloppe budgétaire. Tant que les gens ne crient pas très fort, personne n’agira“. Ils semblent avoir été entendus car les principaux candidats à la législative formulent des propositions pour développer le programme. Preuve que le lycée français n’est plus un horizon indépassable.