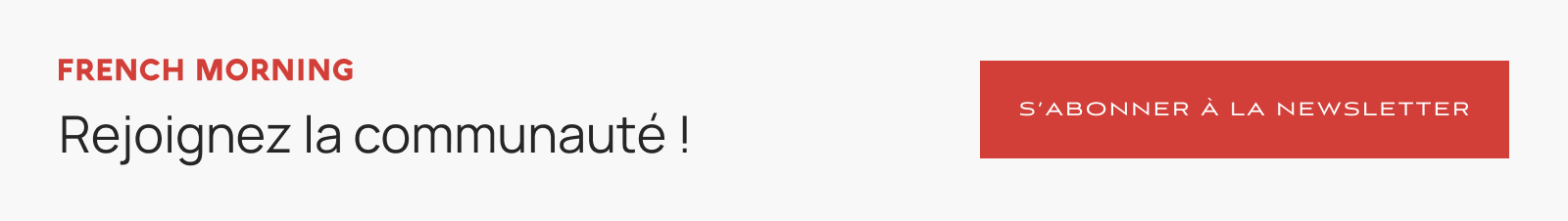Je me souviens parfaitement du jour où j’ai compris qu’en tant que Française, j’étais une mère différente. C’était peu de temps après notre arrivée à New York, au supermarché de notre très bobo quartier de Park Slope à Brooklyn. Le caddy plein, je m’approche des caisses où sont disposés, à nez d’enfant, bonbons et barres chocolatées. Sans surprise, mon fils aîné, alors âgé de 4 ans, me réclame une sucrerie. Suite à mon refus, il se met à hurler et s’écroule à terre. Ses cris s’éternisant, je finis, exaspérée, par lâcher, haut et fort, un franc « NON et ça suffit! ».
Soudain, le temps s’est arrêté. Tous les visages se sont tournés vers moi, les critiques indignées ont sifflé, les “poor little boy” ont bourdonné de toute part et, ultime humiliation, la caissière m’a brutalement signifié qu’elle prenait sa pause en apposant, d’un geste ferme, la pancarte “closed” sur son tapis roulant. Je n’oublierai jamais, ni son regard plein de mépris, ni celui de mon fils, mi-supris mi… satisfait.
En 7 ans de vie aux États-Unis, j’ai connu de nombreux moments de solitude comme celui-là. Des drôles et des moins drôles. Toujours avec cette sensation d’être une mère différente car française. Sommes-nous plus sévères? Oui je pense, quant à la conduite à tenir vis à vis des adultes notamment. Sommes-nous plus relaxes? Certainement aussi, quand nous privilégions le savoir-vivre – ce que j’appelle le savoir-profiter français. Sans prétention aucune (le titre provocateur de cet article n’est qu’un clin d’oeil à l’article du Wall Street Journal “Pourquoi les mères chinoises sont supérieures“) et avec une grande tendresse pour toutes les mères américaines, plus diverses que je ne le laisse entendre ici, je vais tenter de décrire “l’éducation à la française” en terre américaine, telle que je la vis au quotidien avec mes 3 enfants âgés de 10, 8 et 4 ans (et avec mon mari, évidemment pleinement impliqué dans l’éducation, comme le sont beaucoup de pères aujourd’hui. Ils ne sont exclus de cet article que par commodité d’écriture, et par imitation du principe adopté par Amy Chua qui a lancé la polémique).
“Peerenting” vs “parenting”
A la manière d’Amy Chua, l’auteure du livre controversé “The Battle Hymn of the Tiger Mother” et de l’article du Wall Street Journal qui a tout déclenché, voici la liste de ce que mes enfants n’ont pas le droit de faire:
-manquer de respect,
-sortir de table au bout de 5 minutes,
-lors d’un playdate chez les voisins, ouvrir le réfrigérateur sans y être invité sous prétexte d’avoir faim,
-sauter sur le lit des parents (surtout sur celui des voisins),
-se plaindre de l’abondance des devoirs et contredire son professeur, sauf quand il a tort,
-penser que gagner et perdre, c’est pareil, et, du coup, réclamer une récompense quand on a perdu.
Mon amie Liz, mère américaine de 4 enfants, trouve les petits Français plus polis et plus calmes car, analyse-t-elle, ils savent vivre très tôt avec les adultes. On leur apprend, dès leur plus jeune âge, à s’asseoir et à bien se tenir à la table des grands, à se servir d’une fourchette et d’un couteau. J’ai rarement vu un jeune américain attablé plus de 5 minutes, même à l’adolescence. Un paradoxe dans un pays où le dîner de Thanksgiving est tant respecté. Les repas sont souvent pris sur le pouce, debout, et les enfants, entre 2 snacks, apprennent vite à faire leurs sandwiches. Chez les autres, même chose: plus d’une fois j’ai retrouvé, dans ma cuisine, un petit invité le nez fourré dans un placard ou dans le réfrigérateur, m’expliquant « I am hungryyyy ».
Les enfants français apprennent donc tôt à vivre avec les adultes, mais aussi à reconnaître et respecter les espaces de chacun. Combien d’appartements et de maisons d’amis américains sont transformés en vaste playroom, les jouets traînant partout, du salon à la cuisine en passant par la chambre des parents! J’ai surpris un jour ma petite voisine (8 ans, plus si petite que cela) en train de sauter sur notre lit conjugal. Elle ne s’est même pas arrêtée à mon arrivée.
Poser des limites est difficile pour les mères américaines. Elles reconnaissent ne pas avoir été élevées ainsi mais s’estiment “meilleures” que leurs parents car plus à l’écoute. Heurter la sensibilité de leurs enfants est leur hantise. A toute tentative, elles s’entendent dire «you hurt my feelings!» et le processus de culpabilité est aussitôt enclenché. Elles se perdent en explications, argumentations et négociations. J’admire leur patience! Les mères françaises ont beaucoup moins de scrupules. On a toutes lu Dolto, on discute volontiers mais quand l’heure du “non” a sonné, l’explication de texte est terminée.
Qu’on ne s’y trompe pas: les Américaines sont lucides. Par un jeu de mots phonique, elles dénoncent le “peerenting” (le fait de faire copain-copain avec son enfant) comme substitut du “parenting”. Des séries télévisées comme Parenthood le décrivent avec humour. Il y a une réelle prise de conscience et c’est, je pense, l’une des raisons de l’incroyable ampleur de la polémique suscitée par le livre d’Amy Chua.
“Good job” vs “peut mieux faire”
J’ai toujours aimé le positivisme des Américains, leur façon d’encourager, de valoriser l’effort. Mais les “good try”, “good job” et autre “good work” à tout bout de champ, ça n’a plus de sens. Je fus surprise dernièrement de lire un “You did it!” en commentaire d’une note B sur la copie de ma fille (3rd grade, équivalent CE2) ou encore un “excellent” accolé aux 90% du test de mon fils aîné (5th grade, équivalent CM2). Sans perdre une seconde, j’ai expliqué à mes enfants qu’un professeur n’avait pas toujours raison et que seuls A+ et 100% étaient excellents, pas les notes inférieures. Sans hurler pour un A- comme le ferait une mère chinoise, je réserve mes félicitations à l’obtention de la meilleure note. Et dire que je détestais les “peut mieux faire’” sur les bulletins scolaires de mon enfance!
Sur l’ensemble des mères américaines que j’ai eu l’occasion de rencontrer, j’estime à 70% le nombre d’entre-elles qui se sont plaintes de l’abondance des devoirs de leurs enfants. Je n’ai que très rarement entendu une Française en parler. Avoir beaucoup de devoirs nous semble “normal”. Pourtant, les mères américaines sont très préoccupées, voire stressées par les résultats scolaires de leurs enfants et, ce, dès leur entrée en crèche. Un ami new-yorkais, plein d’humour et père attentif de 2 garçons, m’a dit un jour: « avec vous les Français, il faut toujours que les enfants en bavent un peu. Il y a toujours cette idée que, pour y arriver, pour apprendre, il faut souffrir. » Ce doit être notre côté chinois…
Le Dieu Sport
Le sport est, je pense, LE sujet qui marque le fossé culturel entre Français et Américains. Tout le monde le sait, le sport est au coeur de la vie américaine, il est omniprésent, 7 jours sur 7, à l’école comme en dehors. En suburb, il est même déifié: Dieu baseball dans le Connecticut, Dieu Lacrosse à Long Island et dans le New-Jesey. Les mères s’épuisent à conduire leurs enfants aux multiples practices et games. Elles les encouragent d’un “have fun!” mais scrutent de près les résultats. Dans l’esprit “good job”, des médailles sont distribuées même aux perdants. Mais les mères rêvent toutes de la victoire. Elles peuvent en perdre leur sang-froid, fait rarissime chez les Américaines. Une amie de Long Island déplorait s’être fâchée avec la moitié de son quartier après avoir reçu des critiques acerbes sur la façon dont son mari (bénévole) coachait l’équipe de football, ladite équipe venant d’essuyer une défaite. La première fois que j’ai inscrit l’un de mes fils à la ligue de baseball de notre ville, je n’ai pas cru ce que je lisais: des pages entières consacrées au fairplay destinées, non aux enfants, mais aux parents! En avril dernier, je me suis arraché les cheveux à tenter d’organiser les 10 ans de mon aîné, de réunir ses plus proches amis. J’ai dû changer maintes fois la date et l’horaire en raison des différentes activités sportives de chacun. Toutes les mères américaines, avec sincérité, m’ont expliqué combien la présence de leur enfant à tel ou tel match était indispensable: « tu comprends, l’équipe compte sur lui/elle. Sans lui/elle ils risquent de perdre! » C’est là que le savoir-vivre français se distingue, cette touche “à la cool” relevant d’un certain savoir-profiter du bon temps: aucune compatriote n’a décliné l’invitation, car, dans l’esprit français, rien ne vaut un bon verre de vin entre amis pendant que les enfants improvisent… une partie de foot!
Le cas de la fessée
Je ne suis pas une grande adepte de la fessée. J’avoue l’avoir déjà donnée, mais ce fut un fiasco: ça faisait rigoler mon fils aîné. Beaucoup de Françaises expatriées me disent avoir recours à la fessée – en cas extrême. J’en ai même rencontré une qui, une fois la correction donnée, enfermait sa fille dans le placard pour mieux la calmer. Aucune Américaine ne m’a avoué avoir un jour levé la main sur leur enfant. Sûrement par conviction de l’inutilité de ce genre de punition. Mais un peu aussi par crainte d’éventuelles représailles. Judiciaires j’entends. Je l’ai compris lors de ma 2e visite aux urgences de l’hôpital Methodist de New York.
Notre fils, grand cascadeur devant l’éternel, s’était blessé au menton, à peine 2 semaines après s’être ouvert le front. Rien de méchant – quelques points de suture – mais 2 blessures en 15 jours justifiaient un interrogatoire plus serré qu’à ma première visite. Les questions de l’assistante médicale portaient non seulement sur la manière dont mon fils s’était fait mal, mais aussi sur l’environnement familial et la nature des relations entre mon mari et moi. Le temps que je réponde, une femme s’était approchée de mon fils pour l’interroger à son tour. Il ne s’agissait ni d’un médecin ni d’une nurse mais… d’une avocate! Elle n’a heureusement pas insisté quand je l’ai violemment congédiée.
S’il est absolument nécessaire de protéger les enfants et de dénoncer la maltraitance, il est certain que ce climat de suspicion permanente rend les parents américains paranoïaques. J’ai d’ailleurs pensé à ma mésaventure quand j’ai lu la tribune d’Amy Chua dans le Wall Street Journal. Je me suis demandée si l’auteure ne risquait pas de voir débarquer chez elle les services sociaux.
Je suis loin d’être une mère modèle et mes enfants des exemples de sagesse. Contrairement à Amy Chua, dont la fille jouait au Carnegie Hall à l’âge de 15 ans, mes enfants ne montrent pas (encore!) de prouesse particulière qui serait due à l’éducation que je leur prodigue. Mais il y a définitivement un style d’éducation à la française, qui, je pense, profite à mes enfants, ces petits Frenchies « so polite and well behaved » qu’on invite toujours avec le sourire!
Pourquoi les mères françaises sont supérieures…
Par Elisabeth Guédel / Le 24 janvier 2011 / Actualité
DERNIÈRES NEWS
French Morning
Rejoignez la communauté !
S’ABONNER À LA NEWSLETTER